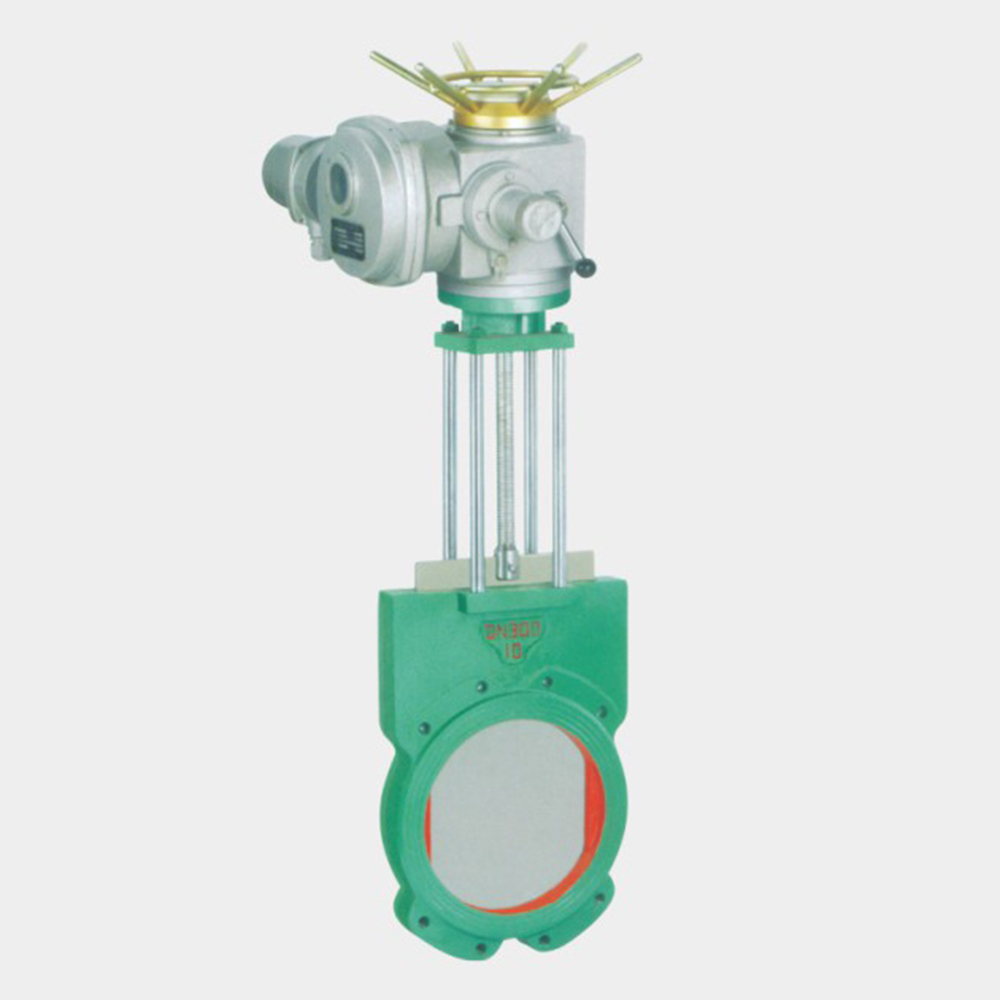0102030405
Réducteur de pression à revêtement époxy en fonte ductile
2021-10-12
Le changement climatique est le défi décisif de notre époque. Cette chronique présente le numéro spécial du « Journal of Economic Geography » sur le changement climatique, qui fournit une base pour une prise de décision judicieuse en abordant deux thèmes principaux de la géographie économique du changement climatique. Premièrement, le changement climatique produira des effets hétérogènes selon les espaces. Deuxièmement, un aspect clé de l’adaptation humaine au changement climatique est la mobilité géographique. Par conséquent, les restrictions à la mobilité exacerberont les coûts socio-économiques du changement climatique. D'autres ajustements abordés dans ce numéro incluent la fécondité, la spécialisation et le commerce. Même avec une action radicale immédiate, la température de la Terre en 2100 pourrait être d’au moins 3°C plus élevée qu’au moment de la rédaction (Tollefson 2020). Le changement climatique constitue donc un défi décisif de notre époque (la perte de biodiversité est tout aussi urgente). Les scénarios publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) fournissent des modèles complexes des interactions complexes entre les activités humaines et le climat. Cependant, leur modélisation des effets spatiaux hétérogènes et des multiples bords affectés par ce phénomène reste assez simple (Cruz et Rossi-Hansberg 2021a, 2021b). Pour répondre aux préoccupations d'Oswald et Stern (2019) et donner suite aux efforts récents, tels que le numéro spécial de la revue de politique économique (Azmat et al., 2020), nous avons rassemblé cinq articles dans le nouveau numéro spécial du journal de politique économique. La géographie économique (JoEG) contribue à combler ces lacunes et à aborder des aspects importants des deux thèmes principaux de la géographie économique du changement climatique. 1 Premièrement, les effets du changement climatique sont spatialement hétérogènes. À leur tour, certaines régions du monde perdront plus de population et de production par habitant que d’autres, et certaines régions pourraient même s’améliorer grâce à cela. Plusieurs articles de ce numéro spécial documentent cette hétérogénéité à une échelle spatiale fine. Par exemple, la figure 1 montre le changement de température prévu provoqué par une augmentation de 1°C de la température mondiale avec une résolution de 1° x 1° en 2 200,2 ans. L’hétérogénéité qui en résulte est étonnante. Deuxièmement, les humains (et les autres espèces) doivent s’adapter pour survivre. L’éventail d’actions visant à atténuer le changement climatique comprend la réduction de l’intensité en carbone et en méthane des habitudes de consommation et des processus de production. Plusieurs articles de ce numéro spécial mettent l’accent sur l’adaptation par la migration et la mobilité géographique. Ces articles soulignent en particulier à quel point le manque de mobilité peut exacerber les coûts socio-économiques du changement climatique. Dans le premier article du numéro spécial, Conte, Desmet, Nagy et Rossi-Hansberg (2021a ; voir aussi Conte et al., 2021b) ont parlé des deux thèmes ci-dessus, et nous avons organisé cette chronique Vox en fonction de leurs perspectives. L’auteur introduit un modèle quantitatif de croissance spatiale dynamique, à l’image des travaux pionniers de William Nordhaus (1993), caractérisé par une relation bidirectionnelle entre activité économique, émissions de carbone et température. Il est important de noter que l’analyse permet d’identifier deux secteurs (agricoles et non agricoles) sensibles à l’hétérogénéité des températures et à une décomposition spatiale très fine. Les auteurs ont fourni à leur modèle des données sur la population mondiale, la température et la production du secteur. La résolution est de 1° x 1°, et l’augmentation du stockage de carbone et de la température mondiale suite au scénario du GIEC à forte intensité de carbone (appelée concentration représentative) est de 8,5. En utilisant un tel modèle calibré, ils l’ont laissé fonctionner pendant 200 ans pour quantifier l’hétérogénéité spatiale du changement climatique sur la population, le PIB par habitant et la combinaison de production agricole et non agricole. Ils ont également souligné le rôle du commerce et de la migration dans l’atténuation ou l’amplification de la perte par unité spatiale de 1° x 1° causée par le changement climatique. La scène initiale de Conte et al. (2021a) Supposons que les frictions entre les flux de population et de matières premières soient constantes dans le temps. Leur modèle prédit que la population de la Scandinavie, de la Finlande, de la Sibérie et du nord du Canada augmentera, ainsi que le revenu par habitant. L’Afrique du Nord, la péninsule arabique, le nord de l’Inde, le Brésil et l’Amérique centrale présenteront quelques différences sur ces deux aspects. déclin. La figure 2 reproduit la figure 6 de leur article, décrivant l'impact du changement climatique sur la population prévue en 2200. L'agriculture est devenue plus concentrée dans l'espace et s'est déplacée vers l'Asie centrale, la Chine et le Canada. Ces scénarios impliquent d’importants mouvements de population à l’intérieur et entre les pays, en particulier lorsque les coûts du commerce sont élevés. Par conséquent, les obstacles à la mobilité peuvent entraîner une réduction significative de l’efficacité. Remarque : Cette figure montre le logarithme de la population prévue de 2 200 habitants par rapport à la population prévue en l’absence de changement climatique. La population de la zone bleu foncé devrait plus que doubler ; la zone rouge foncé devrait perdre plus de la moitié de sa population. Les articles de Castells-Quitana, Krause et McDermott (2021) complètent ce travail de deux manières. Premièrement, il propose une analyse de régression rétrospective pour quantifier l’impact du changement climatique passé sur la migration urbaine-rurale (voir également Peri et Sasahara 2019a, 2019b), et Conte et al. (2021a) est principalement un exercice de prévision. Deuxièmement, il a étudié les effets de l’évolution des précipitations et des températures à long terme (1950-2015) sur le taux d’urbanisation et la structure des grandes villes de divers pays. Surtout, ils tiennent compte des effets hétérogènes entre les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire et à revenu élevé, et étudient l'impact sur la structure urbaine globale du pays ainsi que sur la taille, la densité et la forme urbaines. Ils ont constaté que dans les pays avec des conditions climatiques initiales défavorables, la détérioration des conditions climatiques (températures plus élevées et précipitations plus faibles) est liée à des taux d'urbanisation plus élevés, et ces effets sont particulièrement forts dans les pays en développement et affectent diverses dimensions de la densité et de la croissance des villes, notamment les plus grandes zones métropolitaines. Un autre aspect important qui complète l’impact économique du changement climatique est son impact sur les tensions et conflits sociaux locaux. L'article de Bosetti, Cattaneo et Peri (2021) a analysé si la migration transfrontalière entre 1960 et 2000 a affecté le lien entre la hausse des températures et les conflits dans 126 pays. D’une part, la hausse des températures et les sécheresses plus fréquentes augmenteront la rareté des ressources locales, affectant ainsi la possibilité de conflits locaux (par exemple, Hsiang et al., 2011). En revanche, le modèle économique de l’immigration de Conte et al. (2021a) montre qu’en raison de la baisse de productivité due au changement climatique, la mobilité réduit les pertes économiques. Bosetti et al. En combinant ces deux constats, il prouve que dans les pays pauvres, la probabilité de conflits internes est positivement corrélée à la température, et cette corrélation est particulièrement forte dans les pays à faible tendance à émigrer. L'immigration, en tant que « soupape de fuite », est soumise à des pressions économiques. Soulager la pression démographique dans les pays en développement où la productivité agricole est en déclin semble être un moyen efficace de réduire le risque que ces zones ne deviennent des conflits locaux. L’impact du changement climatique sur la fertilité n’a pas été exploré. La solution à ce problème est l'article de Green (2021), qui examine la relation entre les chocs climatiques et les transitions démographiques aux États-Unis de 1870 à 1930. L'auteur a enregistré une corrélation positive entre les changements de précipitations dans une zone et la différence de fécondité entre ménages agricoles et non agricoles. Dans les sociétés rurales, lorsque le changement climatique et l’incertitude accroissent les changements dans la productivité agricole, le travail des enfants fournit des ressources supplémentaires ; par conséquent, les ménages ruraux peuvent augmenter les taux de fécondité, et ce mécanisme ne fonctionne pas dans les ménages urbains. Le changement climatique entraîne une élévation du niveau de la mer et une augmentation de la fréquence des ouragans et des typhons. Les zones côtières sont particulièrement dangereuses. 3 Utiliser l'approche conceptuellement proche de Conte et al. (2021a), Desmet et al. (2021) Estimer le coût économique des inondations côtières. Un article d'Indaco, Ortega et Taspinar (2021) dans le numéro spécial de JoEG complète l'article en documentant l'impact de l'ouragan Sandy sur les affaires de la ville de New York. Les inondations de 2021 ont entraîné des réductions hétérogènes de l’emploi (environ 4 % en moyenne) et des salaires (environ 2 % en moyenne), et l’impact de Brooklyn et du Queens a été plus important que celui de Manhattan. Ces effets hétérogènes reflètent l’hétérogénéité de la gravité des inondations et de la composition industrielle. De Smet et coll. (2021) A développé un modèle dans la même famille que Conte et al. (2021a) On estime que la perte économique causée par les inondations côtières en 2200 passera de 0,11 % du revenu réel lorsque la réponse migratoire est autorisée à 4,5 % lorsque la réponse n'est pas autorisée. Les trois autres articles de ce numéro spécial se concentrent également sur le rôle de la migration en tant que mécanisme d'adaptation au changement climatique. Castells-Quitana et al. (2021) A documenté la migration des zones rurales vers les villes à l'intérieur des frontières nationales et s'est concentré sur la mobilité en tant que force affectant les conséquences de l'urbanisation du changement climatique. Bosetti et al. (2021) analyse comment les migrations transfrontalières entre 1960 et 2000 ont affecté le lien entre réchauffement et conflit dans 126 pays. 4 L'immigration réduit l'impact de la hausse des températures sur la possibilité d'un conflit armé, tout en n'augmentant pas la possibilité de conflits dans les pays voisins (pays d'immigration). La mobilité est également importante pour les entreprises et les employeurs. Indak et coll. (2021) montre que les entreprises s’adaptent aux risques d’inondation en délocalisant leurs institutions, et que certaines entreprises peuvent même bénéficier des inondations. La capacité de délocalisation dépend du secteur d'activité, mais de manière générale, la mobilité de l'entreprise est aussi un espace clé pour s'adapter au changement climatique. Conté et coll. (2021a) On constate également que l’immigration et le commerce sont des substituts. Les fortes frictions commerciales constituent un obstacle à l'adaptation du mix de production local au changement climatique, car le passage à l'autosuffisance empêche l'utilisation des avantages comparatifs croissants d'une région. Cela encourage la migration des zones les plus touchées vers les zones les moins touchées par la hausse des températures. Il est intéressant de noter que ces régions sont concentrées en Europe, au Japon et aux États-Unis, pays à forte productivité. Par conséquent, des coûts commerciaux élevés n’entraîneront pas des coûts climatiques toujours plus élevés. Les travaux récents de Cruz et Rossi-Hansberg (2021a, 2021b) complètent également ceux de Conte et al. (2021a), en considérant les deux autres aspects des changements induits par le climat : le confort et la fertilité. Bien qu’il ne soit pas encore entièrement exploré, le canal de la fécondité occupe une place centrale dans l’article de Green (2021). Grimm a analysé les différences de fécondité entre les ménages agricoles et non agricoles du comté au fil du temps pour déterminer l'impact causal des risques de pluie et de sécheresse sur les transitions démographiques. Il a constaté que la différence des taux de fécondité dans les zones présentant de grands changements de précipitations était significativement plus élevée que dans les zones de faibles changements de précipitations. Il est intéressant de noter que cet effet a disparu lorsque l’irrigation et les machines agricoles ont affaibli le lien entre les changements de précipitations et le rendement. En fin de compte, nous devons analyser une série de conséquences complexes du changement climatique sur l’économie et la société. Nous devons considérer non seulement les canaux, les mécanismes et l’hétérogénéité qui nous guident pour comprendre l’impact, mais aussi les études de cas et les analyses empiriques plus ciblées. Un ou plusieurs d'entre eux, et fournir des détails et la causalité. Nous avons rassemblé des articles révolutionnaires combinant ces deux méthodes dans ce numéro spécial du Journal of Economic Geography. Nous espérons que ces articles encourageront la recherche et davantage d’interactions entre microéconomistes et macroéconomistes qui étudient les conséquences du changement climatique. Azmat, G, J Hassler, A Ichino, P Krusell, T Monacelli et MSchularick (2020), « Appel à impact : numéro spécial de politique économique sur l'économie du changement climatique », VoxEU. Organisation, 17 janvier. Balboni, C (2019), â???? En danger ? Investissement dans les infrastructures et durabilité des villes côtières ????, document de travail, Massachusetts Institute of Technology. Bosetti, V, C Cattaneo et G Peri (2021) : doivent-ils rester ou partir ? Migration climatique et conflits locaux-Journal of Economic Geography 21(4), numéro spécial de Economic Geography of Climate Change. Castells-Quitana, D, M Krause et T McDermott (2021), « Les forces d'urbanisation du réchauffement climatique : le rôle du changement climatique dans la répartition spatiale de la population », Journal of Economic Geography 21 (4), Géographie économique du changement climatique Étudiez le numéro spécial. Cattaneo, C, M Beine, C Fröhlich, etc. (2019), â???? La migration humaine à l’ère du changement climatique. ???? Examen de l'économie et des politiques de l'environnement 13 : 189-206. Cattaneo, C et G Peri (2015), « Immigration » Response to Temperature Rise-VoxEU, 14 novembre. Cattaneo, C et G Peri (2016), â???? Réponse migratoire à l’augmentation de la température. un???? Journal of Development Economics 122 : 127–146. Conte, Bruno, Klaus Desmet, Dávid K Nagy et Esteban Rossi-Hansberg (2021a), « Spécialisation du secteur local dans un monde en réchauffement », Journal of Economic Geography 21(4), numéro spécial sur la géographie économique du changement climatique. Conte, B, K Desmet, DK Nagy et E Rossi-Hansberg (2021b), « Adapting to trade: Changing spécialisation to combat Climate Change », VoxEU.org, 4 mai. Cruz, JL et E Rossi-Hansberg (2021a) , « La géographie économique du réchauffement climatique », CEPR Discussion Paper 15803. Cruz, JL et E Rossi-Hansberg (2021b), « Bénéfices inégaux : évaluation de l'impact économique global et spatial du réchauffement climatique », VoxEU.org, 2 mars. Desmet, K, DK Nagy et E Rossi-Hansberg (2018), « S'adapter ou être dépassé » ? ? , VoxEU.org, 2 octobre. Desmet, K, RE Kopp, SA Kulp, DK Nagy, M Oppenheimer, E Rossi-Hansberg et BH Strauss (2021), « Évaluation du coût économique des inondations côtières » ? ? , American Economic Journal : Macroéconomie 13 (2) : 444-486. Grimm, M (2021), « Risque de pluie, taux de fécondité et développement : preuves des établissements agricoles pendant la période de transition des États-Unis », Journal of Economic Geography 21(4), Climate Economic Geography Special Issue Change. Hsiang, SM, KC Meng et MA Cane (2011), ??? La guerre civile est liée au climat mondial – Nature 476 : 438 – 40 Indaco, A, F Ortega et S Taspinar (2021), « Hurricane, Flood Risk, and Business Economic Adaptation », « Journal of Economic Geography" 21(4), "Economic Geography" Numéro spécial sur le changement climatique. Lin, T, TKJ McDermott et G Michaels (2021a), "Cities and Sea Level", CEPR Discussion Paper 16004. Lin, T, TKJ McDermott et G Michaels (2021b), â?????? Pourquoi construire des logements dans les zones côtières sujettes aux inondations ? , VoxEU.org, 22 avril. Nordhaus, WD (1993), « Lancez les dés » : la meilleure voie de transition pour contrôler les gaz à effet de serre, Économie des ressources et de l'énergie 15(1) : 27-50. Oswald, A et N Stern (2019), « Pourquoi les économistes déçoivent-ils le monde sur le changement climatique ???? VoxEU.org, 17 septembre. Peri, G et A Sasahara (2019a), « L'impact du réchauffement climatique sur les migrations urbaines et rurales : données probantes issues du Big Data mondial », document de travail NBER 25728. Peri, G et A Sasahara (2019b), « L'impact du réchauffement climatique sur la migration rurale-urbaine-", VoxEU.org, 15 juillet. Tollefson, J (2020). un???? Comment la Terre pourrait-elle ne pas l’obtenir d’ici 2100 ? â????, article Nature News, avril. doi.org/10.1038/d41586-020-01125-x Yohe, G et M Schlesinger (2002). « La géographie économique des impacts du changement climatique » ????, Journal of Economic Geography 2(3) : 311-341. 2 Cette figure reproduit la figure 5 de l'article de Conte Desmet, Nagy et Rossi-Hansberg (2021). Nous remercions ces auteurs d’avoir partagé leurs données avec nous. 3 Lin et coll. (2021a, 2021b) ont enregistré une augmentation alarmante (de 12 % à 14 %) des logements construits dans les zones côtières à risque d’inondation le long de l’Atlantique et du golfe du Mexique entre 1990 et 2010. Balboni (2019) a souligné que les investissements passés dans Les infrastructures peuvent expliquer la pérennité des villes côtières. 4 Yohe et Schelsinger (2002) et Cattaneo et al. (2019) ont également enregistré la réponse de l’urbanisation à la hausse des températures ; Cattaneo et Peri (2015, 2016) ont enregistré la réponse de la migration internationale.